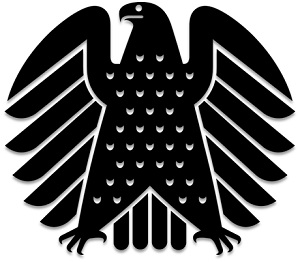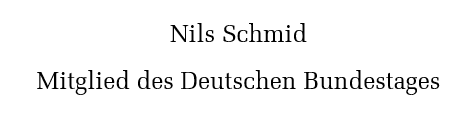Cet entretien a été conduit par Thomas Wieder (Correspondant du Monde à Berlin)
Peu de pays ont été amenés à réviser leur politique étrangère et de défense aussi profondément que l’Allemagne après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Un terme résume cette remise en cause : celui de Zeitenwende (« changement d’époque »), utilisé par le chancelier Olaf Scholz à la tribune du Bundestag, le 27 février 2022, trois jours après le début de la guerre.
Plus d’un an s’est écoulé depuis, et beaucoup s’interrogent sur les changements en cours en Allemagne ainsi que sur la personnalité du successeur d’Angela Merkel, qui reste encore mal connue à l’étranger, en particulier en France. Afin de nous éclairer sur ces questions, nous avons souhaité interroger le député social-démocrate Nils Schmid (SPD). Ancien ministre de l’Économie et des Finances du Land de Bade-Wurtemberg (2011-2016), il est, depuis 2017, membre du Bundestag et porte-parole du groupe social-démocrate pour les questions de politique étrangère. Âgé de 49 ans, proche du chancelier, il fait partie des responsables politiques allemands dont l’expertise est la plus reconnue sur les questions diplomatiques et internationales. Européen résolu, il est également co-président — avec la députée française Brigitte Klinkert (Renaissance, Haut- Rhin) — du bureau de l’Assemblée parlementaire franco-allemande, créée en 2019 et qui réunit, au moins deux fois par an, cinquante députés issus de l’Assemblée nationale et autant de membres du Bundestag.
Thomas Wieder — Le 27 février 2022, trois jours après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Olaf Scholz a prononcé devant le Bundestag un discours que tout le monde s’est accordé à reconnaître comme historique. Il y promettait notamment que l’Allemagne allait sortir de sa dépendance au gaz russe, qu’elle allait investir 100 milliards d’euros pour moderniser son armée, dépenser 2 % de son produit intérieur brut (PIB) pour sa défense, conformément à l’objectif fixé par l’Otan à ses membres, et soutenir l’Ukraine militairement face à la Russie. À l’époque, l’opposition conservatrice (CDU-CSU) avait salué ce discours ; mais, depuis, elle est très critique, reprochant au gouvernement de mettre beaucoup trop lentement en œuvre ce qui a été promis ce jour-là par Olaf Scholz. Que répondez-vous ?
Nils Schmid — Sur l’énergie, la question est réglée. Compte tenu de nos liens avec la Russie, le défi était considérable ; et pourtant nous sommes allés très vite : depuis l’automne 2022, nous avons cessé d’importer du gaz russe, et cela sans mettre en péril notre sécurité énergétique puisque nous avons réussi à diversifier très rapidement nos sources d’approvisionnement en gaz, tout en décidant de rouvrir quelques centrales à charbon de façon transitoire. Je crois que, sur ce plan, personne ne peut dire que ce qui a été annoncé par Olaf Scholz le 27 février 2022 n’a pas été suivi d’effet. Au contraire.
Sur les questions de défense, les choses prennent forcément du temps. On ne transforme pas une armée comme la Bundeswehr du jour au lendemain. Le fonds spécial de 100 milliards d’euros a été voté rapidement, des commandes ont déjà été passées, notamment pour acheter des avions de combat F-35 américains afin de remplacer notre flotte de Tornado. Le grand projet de Système de combat aérien du futur, que nous menons à bien avec la France et l’Espagne, avance lui aussi, mais il s’agit d’investissements qui s’étalent sur plusieurs années. L’important est que la dynamique soit enclenchée, que la volonté politique soit là. Et cela, personne ne peut le contester. De ce point de vue, le nouveau ministre de la Défense, Boris Pistorius (nommé en janvier 2023), fait montre de beaucoup de volontarisme, notamment sur le plan budgétaire, pour mettre en œuvre ce processus de modernisation sans précédent de notre appareil militaire. Même l’opposition le reconnaît.
Je vous le concède, il reste des efforts à accomplir en matière de réorientation de notre politique étrangère, surtout pour ce qui est de la perception du rôle de l’Allemagne sur la scène internationale. Là-dessus, nous avons fait d’importants progrès depuis le début de la guerre en Ukraine et le discours d’Olaf Scholz du 27 février. Nos concitoyens le sentent bien, ce qui explique en partie les débats intenses que nous avons sur les livraisons d’armes. Pour nos partenaires étrangers, c’est parfois plus difficile à comprendre, en particulier pour ceux qui souhaiteraient que nous allions plus vite dans la prise de certaines décisions.
T. W. — Le rapport de l’Allemagne à la guerre est-il en train de changer ?
N. S. — Des mutations très profondes sont en cours, même si, là aussi, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Après la Seconde Guerre mondiale, l’idée qui dominait en Allemagne, était : « Plus jamais la guerre. » Autrement dit, on considérait que la guerre était forcément un mal en soi et qu’aucune guerre n’était juste ou légitime. À la fin des années 1990, au moment de la guerre du Kosovo, il y a eu un débat très vif, et certains, à commencer par le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Joschka Fischer, ont dit : non, la leçon que nous devons tirer du nazisme, c’est avant tout « plus jamais Auschwitz », sous-entendu il faut parfois avoir recours à la guerre pour empêcher des crimes abominables d’être perpétrés. C’est au nom de cet impératif, d’ailleurs, que l’Allemagne a décidé de participer à l’opération de l’Otan au Kosovo, en 1999.
Aujourd’hui, nous avons franchi une nouvelle étape qu’Olaf Scholz a très bien décrite dans un discours qui a assez peu retenu l’attention mais qui, à mon avis, est essentiel pour comprendre où nous en sommes aujourd’hui : celui qu’il a prononcé le 8 mai 2022 à l’occasion de la commémoration annuelle de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La notion qu’il a développée, ce jour-là, est celle d’un « plus jamais » qui ne soit pas seulement le « plus jamais la guerre » ou le « plus jamais Auschwitz ». Autrement dit, sa thèse est qu’il ne faut pas attendre une situation extrême — par exemple un génocide — pour se poser la question de savoir s’il faut intervenir ou non. En l’occurrence, l’agression d’un État souverain par un autre — ce que fait la Russie en Ukraine — est une violation du droit international qui peut justifier le recours à la force militaire, ou tout au moins un soutien militaire pour défendre la partie agressée. C’est un défi, pour nous Allemands, de raisonner ainsi car nous n’étions plus habitués à voir des acteurs étatiques, comme la Russie, utiliser la force brute pour parvenir à leurs fins. C’est pourquoi il est urgent de renforcer notre appareil militaire car, même si on peut le déplorer, on ne peut pas nier que le facteur militaire joue désormais un rôle majeur dans les relations internationales. C’est une réalité que les Allemands perçoivent très bien. Ils ont compris que Poutine ne menace pas seulement la sécurité de l’Ukraine, mais celle de l’Europe tout entière.
T. W. — La perception de la menace russe vous semble-t-elle plus forte en Allemagne qu’en France ?
N. S. — Oui, incontestablement. D’abord, pour une raison géographique évidente : l’Allemagne est plus proche de la Russie que ne l’est la France. Ensuite, pour une raison historique : pendant la guerre froide, c’est la République fédérale d’Allemagne qui constituait le flanc est de l’Otan. Donc, quand les Baltes, les Polonais, les Slovaques ou les Roumains demandent à être davantage protégés par l’Alliance atlantique pour faire face à la menace russe, c’est quelque chose que nous comprenons parfaitement car nous-mêmes avons été en première ligne face au bloc soviétique pendant plus de quarante ans.
T. W. — Qu’attendent de l’Allemagne ces pays de l’est de l’Europe ?
N. S. — Ils attendent un plus fort engagement. Cela m’a frappé, l’année dernière, en 2022, quand je me suis rendu en Lituanie où, comme vous le savez peut-être, l’Allemagne dirige une brigade de l’Otan au sein de laquelle elle a d’ailleurs récemment renforcé ses effectifs. Je dois admettre que, pour un Allemand, il est toujours surprenant d’entendre d’autres Européens réclamer une plus forte présence de la Bundeswehr sur leur territoire, surtout quand cette requête vient de pays qui ont particulièrement souffert des crimes commis par la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c’est la réalité d’aujourd’hui. Dans cette partie de l’Europe, le fait que l’Allemagne devienne une grande puissance militaire ne fait plus peur. Au contraire. Souvenez-vous de la fameuse phrase que le ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslaw Sikorski, avait prononcée à Berlin en 2011 : « Je crains moins la puissance allemande que l’inaction allemande. » Dans ces pays, la perception de la menace russe est telle qu’il existe une volonté de nous voir, nous Européens de l’Ouest, beaucoup plus impliqués dans la défense du continent.
T. W. — Il est intéressant de vous entendre rappeler cette phrase car, douze ans plus tard, la « crainte » exprimée à l’époque par le chef de la diplomatie polonaise n’a pas disparu : à Varsovie comme à Riga, Tallinn ou Vilnius, l’Allemagne continue de se voir reprocher un manque de leadership. Ce fut le cas à propos des livraisons de chars de combat Leopard 2 à l’Ukraine : si Olaf Scholz a fini par donner son feu vert, le 26 janvier 2023, sa décision s’est longtemps fait attendre et on a davantage retenu de lui son hésitation que son volontarisme…
N. S. — Olaf Scholz n’a pas été hésitant, il a simplement été prudent. En démocratie, on ne gouverne pas contre la majorité des citoyens, et le chancelier a dû tenir compte des réserves exprimées par une partie de l’opinion publique dans une Allemagne qui, à la veille de la guerre en Ukraine, avait encore pour doctrine de ne pas livrer d’armes à des pays en guerre.
À ce titre, la stratégie qui est la sienne depuis le début du conflit en matière de livraisons d’armes me semble être la plus responsable politiquement. En tant que député, je le constate dans les discussions que j’ai avec les habitants de ma circonscription : beaucoup de ceux qui sont réticents à propos des livraisons d’armes apprécient d’avoir un chancelier qui prend le temps de réfléchir, qui pèse le pour et le contre et qui ne prend pas ses décisions de façon précipitée, a fortiori sur des sujets aussi graves.
T. W. — Vous parlez de « stratégie ». Quelle est, justement, la stratégie allemande concernant les livraisons d’armes à l’Ukraine ?
N. S. —Notre principe de base, celui auquel nous tenons plus que tout, consiste à agir en étroite concertation avec nos alliés, et notamment avec les Américains. Chaque fois que nous franchissons une nouvelle étape, comme nous l’avons fait début janvier avec l’envoi de véhicules blindés d’infanterie de type Marder, ou fin janvier avec les chars de combat Leopard 2, nous le faisons dans le cadre d’une coalition avec nos partenaires. En agissant ainsi, dans une démarche collective, on évite que Poutine fasse d’un pays en particulier la cible privilégiée d’éventuelles représailles.
T. W. — Dans une interview à la chaîne américaine ABC, le 26 février, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a affirmé qu’Olaf Scholz n’a accepté de livrer des Leopard 2 à l’Ukraine qu’à la condition que les États-Unis annoncent, le même jour, qu’ils fourniraient des chars Abrams aux forces de Kiev. Cette confidence ne vient-elle pas rappeler à quel point Berlin reste tributaire de Washington sur les questions de défense ?
N. S. — S’agissant de l’envoi des Leopard 2, l’Allemagne n’a pas fait dépendre son feu vert de celui des États-Unis sur les Abrams. Mais avant de dire oui, il était important pour nous d’avoir l’assurance qu’il y aurait un soutien politique et sécuritaire de Washington. Et cela, je vous l’ai dit, afin d’éviter une surexposition des Européens aux menaces de la Russie.
Pour répondre simplement à votre question : oui, les États- Unis restent les garants ultimes de la sécurité de l’Allemagne, mais pas seulement de l’Allemagne, de l’Europe tout entière, à l’exception peut-être de la France et de la Grande-Bretagne, qui disposent de la force de dissuasion nucléaire.
Reconnaître cette réalité ne doit toutefois pas nous faire perdre de vue une tendance de long terme, à savoir la moindre implication des États-Unis en Europe, mais aussi en Afrique, en Asie centrale ou au Proche-Orient. Quel que soit le prochain président américain, ce mouvement de retrait — diplomatique et militaire — va se poursuivre, et les Européens doivent s’y préparer, à la fois en investissant beaucoup plus dans leur propre sécurité et en s’impliquant davantage dans la stabilisation des régions situées dans le voisinage de l’Union européenne.
T. W. — Dans un document publié en janvier par votre parti, le SPD, sous le titre « Réponses sociales-démocrates à un monde en mutation », on peut lire : « En raison de la taille et du poids économique de l’Allemagne, les partenaires européens de celle-ci attendent qu’elle assume ses responsabilités et qu’elle exerce un rôle de leader (« Führungsrolle »). » Qu’est-ce que cela signifie précisément ?
N. S. — Je l’ai évoqué il y a un instant : dans notre esprit, il s’agit d’un leadership collectif. Cela a été le cas sur les livraisons d’armes. Vous rappeliez tout à l’heure que la Pologne ou les pays baltes auraient souhaité que l’Allemagne mît moins de temps à se décider sur les chars de combat. On peut les comprendre, compte tenu de leur histoire et de leur proximité avec la Russie ; mais il y avait aussi d’autres pays européens, dont la France, qui étaient sur une ligne plus prudente, et c’est justement parce qu’elle a ce souci du collectif que l’Allemagne a agi comme elle l’a fait. En ne s’alignant pas à 100 % sur la position de la Pologne et des États baltes, mais en entendant les arguments des uns et des autres et en cherchant à organiser une réponse commune, elle a montré qu’elle entendait jouer ce rôle de pont entre l’est, l’ouest, le nord et le sud de l’Europe.
T. W. — Vous dites qu’Olaf Scholz a le « souci du collectif » mais, vu de l’étranger, ce n’est pas toujours ainsi qu’il est perçu. Deux exemples : le plan anti-inflation de 200 milliards d’euros que Berlin a annoncé, fin septembre 2022, sans en informer préalablement ses partenaires européens ; puis le choix fait par le chancelier allemand, début novembre, de se rendre à Pékin sans le président français, Emmanuel Macron, qui avait pourtant proposé de l’accompagner. Dans les deux cas, n’est-ce pas à raison que l’Allemagne a été accusée de faire « cavalier seul » ?
N. S. — Très franchement, je pense qu’il s’agit d’un mauvais procès. Il me semble qu’on peut comprendre qu’Olaf Scholz, pour son premier déplacement en Chine en tant que chancelier, y soit allé seul. À ma connaissance, Emmanuel Macron n’était pas accompagné d’Angela Merkel pour son premier voyage à Pékin comme président de la République (en janvier 2018), et personne ne s’en était offusqué.
S’agissant du plan de 200 milliards d’euros, peut-être que le gouvernement allemand aurait pu mieux communiquer, mais il ne faut pas être hypocrite : tous les pays européens, dont la France, ont réagi à la flambée des prix de l’énergie avec leur propre arsenal de mesures. On peut le regretter et déplorer qu’il n’y ait pas eu plus de coordination à l’échelle européenne, mais c’est un fait : dès qu’il y a une crise, il y a dans tous les pays un réflexe naturel de retour aux solutions nationales. Or, dans la crise actuelle, cette attitude pose d’autant plus de difficultés que sur la question de l’énergie, aujourd’hui centrale, chaque État a jusqu’à présent mené sa propre politique sans vraiment tenir compte des autres. Inévitablement, cela crée des tensions, en particulier entre la France et l’Allemagne, dont les mix énergétiques sont très différents. Ce ne sont pas des choses que l’on découvre, mais ce qui était pendant longtemps considéré comme une divergence secondaire entre Paris et Berlin est devenu, avec la guerre en Ukraine, un vrai problème à surmonter.
T. W. — Tous les observateurs en conviennent, la relation franco- allemande traverse une période difficile. On a pu s’en rendre compte lors du 60e anniversaire du traité de l’Élysée, le 22 janvier. Emmanuel Macron et Olaf Scholz auraient pu saisir l’occasion pour faire des annonces fortes. Or ce ne fut pas le cas, et la déclaration commune publiée à l’issue du conseil des ministres franco-allemand qui s’est tenu ce jour-là à l’Élysée ressemblait plus à un catalogue de bonnes intentions qu’à une feuille de route précise et concrète. En tant que coprésident du bureau de l’Assemblée parlementaire franco- allemande, cela vous inquiète-t-il ?
N. S. — Au risque de vous étonner, ce sont surtout les convergences de vues entre la France et l’Allemagne qui me frappent. Pas dans tous les domaines, bien sûr ; en tout cas pas dans celui de l’énergie que je viens d’évoquer. Mais essayons de voir plus loin. La notion de « souveraineté européenne », par exemple. Quand Emmanuel Macron a employé l’expression dans son discours de la Sorbonne, en 2017, l’Allemagne, à l’époque dirigée par Angela Merkel, ne l’a pas reprise à son compte. Or, aujourd’hui, Olaf Scholz l’utilise régulièrement et le gouvernement allemand adhère totalement à l’idée qu’il faut renforcer l’autonomie de l’Europe, particulièrement en matière de politique étrangère et de défense, ce que réclame la France depuis longtemps.
Il en va de même pour la politique industrielle européenne. Longtemps très réticente, l’Allemagne est aujourd’hui prête à intervenir activement dans ce domaine. De ce point de vue, la coopération entre nos deux pays fonctionne très bien, grâce à l’excellente entente entre nos ministres de l’Économie, Bruno Le Maire et Robert Habeck, qui pilotent plusieurs projets industriels communs, comme la fabrication de batteries électriques ou la production d’hydrogène.
Pour toutes ces raisons, l’état des relations franco-allemandes ne m’inspire aucune inquiétude. En revanche, je pense que la France et l’Allemagne doivent trouver des réponses communes aux préoccupations exprimées par nos partenaires est-européens, Pologne, États baltes, Slovaquie, Roumanie, mais aussi pays des Balkans.
Une idée fausse, mais assez répandue en France, est que l’Allemagne essaierait d’exercer une sorte d’hégémonie sur cette zone-là. Il est vrai que les leaders politiques des pays balkaniques, que ce soit au niveau gouvernemental ou parlementaire, viennent souvent à Berlin pour plaider leur cause parce qu’ils pensent que c’est l’Allemagne qui pourrait créer l’élan nécessaire à leur entrée dans l’Union européenne. C’est lié à nos relations économiques, mais également humaines car il y a beaucoup d’immigrés originaires d’ex-Yougoslavie en Allemagne. Ce qui est clair, c’est que cette relation privilégiée n’est pas le fruit d’un choix délibéré du gouvernement allemand. Je pense que la France aurait tout intérêt, elle aussi, à investir davantage dans ses liens avec ces pays. Il n’y a pas de concurrence franco-allemande sur ce point.
T. W. — Un an et demi après son arrivée au pouvoir, Olaf Scholz reste difficile à cerner. Par sa sobriété, sa modération et sa prudence, il donne le sentiment de beaucoup ressembler à Angela Merkel. Pour vous qui le connaissez bien, une telle perception est-elle fondée ?
N. S. — Sur la forme, on peut être tenté de faire le rapprochement car ce sont deux personnalités qui cultivent une certaine réserve, détestent les coups d’éclat et n’ont aucun goût pour les discours grandiloquents.
Sur le fond, il y a une réelle différence. Contrairement à Angela Merkel, qui était une authentique conservatrice, Olaf Scholz, lui, a souhaité devenir chancelier pour faire de vraies réformes. Sur ce plan, il a tenu ses promesses de campagne, qu’il s’agisse de l’augmentation du salaire minimum, votée dès la première année de son mandat, ou du développement des énergies renouvelables, auquel il a donné un fort coup d’accélérateur aussitôt après son arrivée au pouvoir.
Puisque vous m’interrogez sur Olaf Scholz, je vous dirai que ce qui me frappe, chez lui, est sa connaissance ultra-pointue des dossiers. C’est quelqu’un qui aime entrer dans le détail technique des choses, ce qui explique sans doute qu’il se concentre davantage sur la mise en œuvre de telle ou telle mesure plutôt que sur les effets d’annonce. Mais cette discrétion ne signifie aucunement qu’il est une copie d’Angela Merkel. Quand vous regardez le nombre d’interviews qu’il a accordées ou de discours qu’il a prononcés rien que sur sa conception de la politique étrangère et du rôle de l’Allemagne dans le monde, c’est, en un peu plus d’un an, déjà beaucoup plus que tout ce que l’ancienne chancelière a pu dire en seize années ! Je pense, par exemple, au discours qu’il a tenu à l’Université Charles, à Prague, le 29 août 2022. Certains commentateurs ont pu dire que c’était enfin la réponse de l’Allemagne au discours prononcé par Emmanuel Macron à la Sorbonne en septembre 2017. Une réponse que n’avait justement pas donnée Angela Merkel à l’époque où elle était au pouvoir…
Quelle: politique internationale, no. 179, printemps 2023, p. 191 - 200.